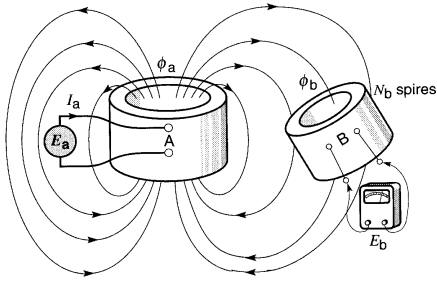
Inductance
Dans cette section, nous étudierons une des propriétés les plus importantes des enroulements. Cette propriété, appelée inductance, permet d'évaluer les tensions induites dans les bobines de même que la quantité d'énergie qu'elles emmagasinent.
L'inductance joue un rôle important dans les circuits à courant continu et à courant alternatif, si bien que tous les domaines de l'électrotechnique sont affectés par cette propriété de base.
Cette section mérite donc une attention toute particulière.
Inductance mutuelle - le henry
Considérons deux bobines A et B plus ou moins rapprochées (Fig. 19-1).
Figure 19-1 La variation de courant dans l'enroulement A induit une tension dans l'enroulement B. C'est le phénomène de inductance mutuelle
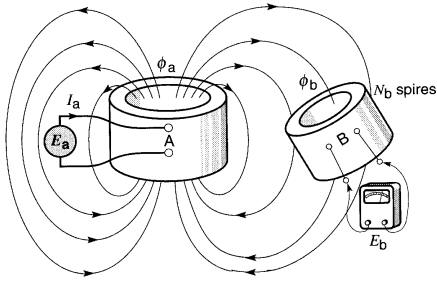
La bobine A est parcourue par un courant I, ; elle crée donc un flux θa dont une partie θb «accroche» les spires de la bobine B.
Lorsque le courant Ia varie, le flux θb varie; donc, d'après la loi de Faraday, une tension est induite entre les bornes de la bobine B. La valeur de la tension est donnée par l'équation 18-2, soit :
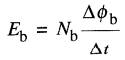 (19-1)
(19-1)
Si le circuit magnétique n'est pas saturé, toute variation de courant ΔIa produit une variation de flux Δθb proportionnelle à ΔIa, ce qui permet d'écrire l'équation:
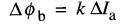 (19-2)
(19-2)
dans laquelle k est un simple facteur de proportionnalité.
En substituant (19-2) dans (19-1) on obtient :
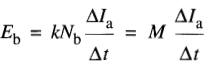
c'est-à-dire
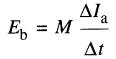 (19-3)
(19-3)
Par définition, le facteur M, nommé inductance mutuelle des deux bobines, donne le rapport entre la tension induite dans une bobine et le taux de variation du courant dans l'autre.
Ce coefficient dépend du nombre de spires des bobines, de leur position relative et des caractéristiques du circuit magnétique qui les relie. L'inductance mutuelle de deux bobines augmente:
(1) si l'on augmente le nombre de spires,
(2) si on les rapproche l'une de l'autre,
ou (3) si on les relie par un noyau magnétique.
L'unité SI d'inductance mutuelle est le henry (symbole H). L'inductance mutuelle de deux bobines est de 1 henry si une variation de courant de 1 ampère par seconde dans l'une induit une tension de 1 volt dans l'autre.
Exemple 19-1
L'inductance mutuelle des enroulements A et B de la Fig. 19-1 est de 3,7 henrys.
Figure 19-1 La variation de courant dans l'enroulement A induit une tension dans l'enroulement B. C'est le phénomène de inductance mutuelle
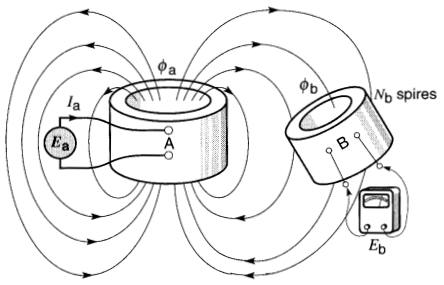
Quelle est la valeur moyenne de la tension induite dans la bobine B lorsquele courant dans la bobine A, décroît de 7 A à 3 A en 2 secondes ?
Solution
Variation de courant ΔI = (7A - 3A) = 4A
Durée de la variation Δt = 2 s
Inductance mutuelle M = 3,7H
En appliquant la formule 19-3, on trouve:
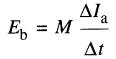
= 3,7 x (4/2) = 7,4V
On remarquera que ce n'est pas le courant dans la bobine A qui engendre une tension dans la bobine B, mais bien la variation de flux (produite par la variation du courant) qui donne naissance à cette tension.
Cependant, en pratique, une formule donnant la tension induite dans une bobine en fonction de la variation du courant dans une autre est plus utile qu'une équation faisant intervenir le flux.
En effet, il est plus facile de mesurer et de suivre les variations d'un courant que les variations d'un flux.
L'inductance mutuelle de deux bobines demeure la même, quelle que soit la bobine qui est alimentée. C'est d'ailleurs une propriété de l'ensemble des deux bobines tout comme leur masse ou leur couleur.
Self-inductance
Considérons la bobine de la Fig. 19-2 portant un courant 1 et produisant un flux θ.
Figure 19-2 La variation du courant I dans la bobine induit une tension entre ses bornes. C'est le phénomène de la self-inductance
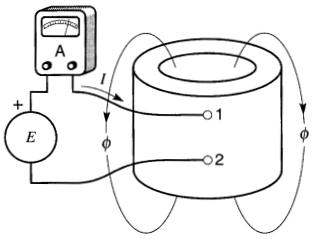
Si le courant varie d'un montant ΔI, cela produira un changement correspondant de flux Δθ.
Cependant, une variation de flux à l'intérieur de la bobine induit une tension entre ses bornes. Nous en venons à la conclusion que le courant variable dans une bobine induit une tension entre ses propres bornes. C'est le phénomène de self-induction.
La tension induite dépend du nombre de spires de la bobine, de sa forme et du taux de variation du courant. Par analogie avec l'induction mutuelle, la valeur de la tension induite est donnée par l'équation:
 (19-4)
(19-4)
où
E = tension induite,
en volts [V]
L = self-inductance de la bobine, en henrys [H]
ΔI = variation du courant, en ampères [A]
Δt = durée de la variation, en secondes [s]
La self-inductance L donne la relation entre la tension induite dans une bobine et le taux de variation du courant qui la parcourt.
Comme pour l'inductance mutuelle, l'unité SI de self-inductance est le henry.
Une bobine possède une self-inductance de 1 henry si une tension de 1 volt est induite lorsque le courant qui la parcourt varie à un taux de 1 ampère par seconde. Notons que le terme self-inductance est habituellement connu sous le nom abrégé d'«inductance».
La Fig. 19-3 montre une inductance de 18 mH pouvant porter un courant de 6400 A.
Figure 19-3 Inductance de lissage de 18 mH, 6400 A. c.c. servant de filtre pour l'alimentation des électro-aimants de guidage du synchrotron à protons du CERN, à Genève. Pesant 35 tonnes et refroidie à l'eau, cette inductance élimine les ondulations du courant pour toute fréquence comprise entre 50 Hz et 3000 Hz
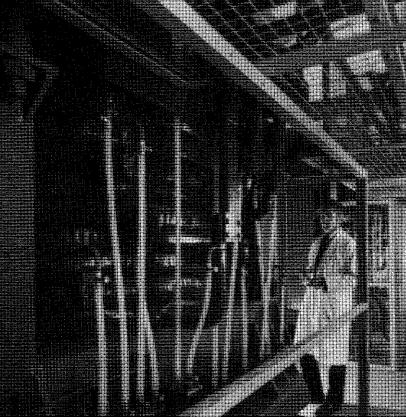
Exemple 19-2
Une bobine ayant une inductance de 2H est parcourue par un courant de 5A lorsqu'elle est raccordée à une pile de 4V (Fig. 19-4).
Figure 19-4
a. Le courant initial dans une bobine est de 5A, la tension à ses bornes est de 4V.
b. Lors de l'ouverture du circuit, le courant diminue rapidement, ce qui induit une tension de 100 V entre les bornes 1 et 2.
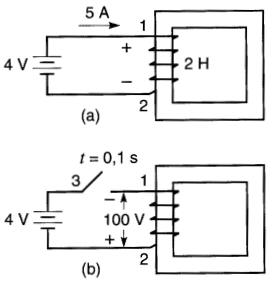
Calculer la valeur moyenne de la tension induite si le courant est interrompu en 0,1 s.
Solution
En appliquant la formule (19-4) on trouve :
E = L (Δi / Δt) = 2 x ((5 - 0) / 0.1) = 100V
On remarque que la tension induite (100 V) est de beaucoup supérieure à la tension de la pile (Fig. 19-4b).
Polarité de la tension induite
La bobine de la Fig. 19-5 est branchée à une source de courant G qui lui fournit un courant I. Supposons que la résistance de l'enroulement soit rigoureusement nulle; il n'y aura donc aucune chute de tension et aucune perte Joule.
Dans l'analyse qui suit nous étudierons ce circuit pour trois conditions différentes :
a) le courant ne varie pas
b) le courant augmente
c) le courant diminue
Si le courant est constant, le flux est constant et aucune tension n'est induite (Fig. 19-5a).
Figure 19-5a Lorsque le courant ne varie pas, la tension entre les bornes est nulle.
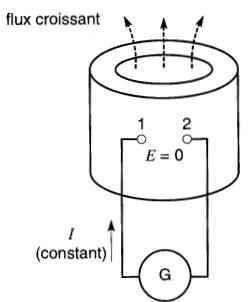
Puisqu'il n'y a aucune chute de tension RI due à la résistance, la tension E aux bornes de l'enroulement est nulle. Lorsque le courant augmente (Fig. 19-5b), le flux augmente et une tension E est induite.
Figure 19-5b Lorsque le courant augmente, une tension est induite et la borne 1 est positive. La bobine agit comme une charge
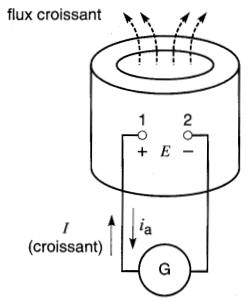
Elle apparaît aux bornes de la bobine. D'après la loi de Lenz, la polarité de cette tension est telle qu'elle tend à s'opposer à la croissance du flux. donc à la croissance du courant I.
Par conséquent, si la tension induite agissait seule, elle produirait un courant i a opposé au courant I. Cela veut dire qu'à l'intérieur de la bobine, ia se dirigerait vers la borne 1. Par conséquent, la borne 1 est (+) par rapport à la borne 2. La tension E12 est donc positive (+).
Lorsque le courant diminue (Fig. 19-5c), le flux diminue et un flux croissant induite et une tension E12 est encore induite. La polarité de cette tension est telle qu'elle tend à s'opposer à la décroissance du courant I.
Figure 19-5c Lorsque le courant diminue, une tension est induite et la borne 1 est négative. La bobine agit comme une source
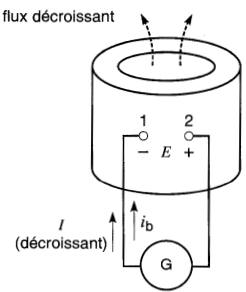
Par conséquent, si la tenon induite agissait seule, elle produirait un courant ib, dans le même sens que I. Afin de produire un tel cousant. il faut que la borne 2 soit (+) par rapport à 1. La tension E12 est donc négative (-).
En comparant les Fig. 19-5b et 19-5c, on constate que la polarité de la tension induite ne dépend pas du sens du courant I, mais de la façon dont il varie.
De plus, la tension induite tend à s'opposer au changement de courant dans la bobine. Il est important de réaliser que le vrai courant circulant dans le circuit est I; les courants ia et ib, sont des courants fictifs utilisés comme artifices pour déterminer la polarité de la tension E12 induite.
La polarité de la tension induite dans une bobine couplée à une autre peut être établie en suivant le raisonnement de l'exemple 18-2 de la section précédent Induction électromagnétique.
Énergie emmagasinée dans le champ magnétique d'une bobine
La polarité en soi n'a pas grand intérêt, mais si on l'associe à la direction du courant I, elle nous conduit à une découverte importante.
Ainsi, la Fig. 19-5b indique que lorsque le courant I augmente, il entre par une borne positive. La bobine se comporte donc comme une charge, absorbant une puissance instantanée de El watts pendant un certain temps.
Qu'arrive-t-il de cette énergie?
Puisque la bobine ne possède aucune résistance, l'énergie n'est pas dissipée sous forme de chaleur. Puisque le montage est immobile. i l n'y a aucune dépense d'énergie mécanique.
On conclut que l'énergie est emmagasinée dans le champ magnétique de la bobine, un peu comme on emmagasine de l'énergie mécanique lorsque l'on comprime un ressort. Dans le cas de la Fig. 19-5c, on constate que lorsque le courant I décroît, il sort par la borne positive.
La bobine se comporte alors comme une source fournissant de l'énergie au reste du circuit. Cette énergie provient du champ magnétique qui doit, par conséquent, décroître. Un enroulement peut donc emmagasiner et restituer de l'énergie comme le fait une batterie de piles. L'énergie est conservée dans le champ magnétique et elle augmente et diminue avec celui-ci.
L'énergie W conservée dans le champ magnétique est donnée par l'équation:
W = (LI²)/2 (19-5)
où
W = énergie dans le
champ [J]
L = inductance de la bobine [H]
I = courant dans la bobine [A]
Exemple 19-3
Une bobine possédant une self-inductance de 4 H est traversée par un courant de 40A (Fig. 19-6a).
Figure 19-6a Voir exemple 19-3
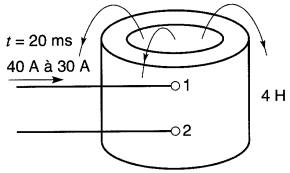
Calculer:
a) la valeur de l'énergie emmagasinée dans le champ magnétique:
b) l'énergie débitée par la bobine si le courant diminue de 40A à 30A:
c) la tension induite aux bornes de la bobine ainsi que la puissance débitée si cette diminution de 40,3% à 30A se fait uniformément en 20 millisecondes.
Solution
a) Pour un courant de 40A, l'énergie conservée dans le champ vaut:
W1 = 1/2 LI² = 1/2 x 4 x 40² = 3200J
b) Lorsque le courant tombe à 30A, l'énergie conservée dans le champ devient:
W2 =1/2 LI² =1/2 x 4 x 30² =1800J
La bobine a donc débité une énergie de:
W = W1 - W2 = 3200 -1800 = 1400J
Cette énergie est retournée au circuit sur lequel la bobine est branchée.
c) La tension induite aux bornes est:
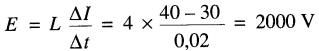
La puissance moyenne débitée par la bobine est :
P = énergie/temps = 1400J / 0,02s = 70 000 W = 70 kW
Les valeurs de E, I et P en fonction du temps sont montrées à la Fig. 19-6b.
Figure 19-6b Tension, puissance
et courant en fonction du temps, lorsque le courant diminue linéairement de 40A
à 30A.
Voir exemple 19-3
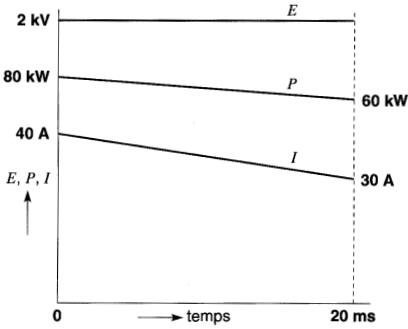
Mise sous tension d'un circuit inductif
Lorsqu'on applique une tension E sur une résistance R, le courant monte immédiatement à une valeur:
I = E / R
conformément à la loi d'Ohm.
La Fig. 19-7 montre le circuit et le graphique du courant en fonction du temps.
Figure 19-7 Graphique du courant dans une résistance en fonction du Temps lorsque l'interrupteur est fermé à t = 0
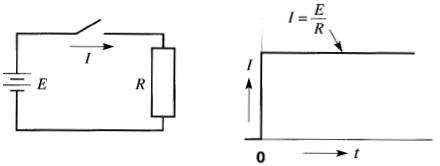
Qu'arrive-t-il lorsqu'on applique une tension constante E sur une bobine ayant une inductance L et une résistance nulle?
D'après l'équation 19-4 on a :
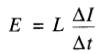
d'où
 (19-6)
(19-6)
Comme E et L sont des constantes, l'équation (19-6) révèle que le taux de variation du courant est constant et égal à E/L. La Fig. 19-8 montre que le courant augmente uniformément avec le temps, à partir de l'instant de fermeture du circuit.
Figure 19-8 Graphique du courant dans une inductance (bobine ou spire) enfonction du temps, lorsque l'interrupteur est fermé à t = 0
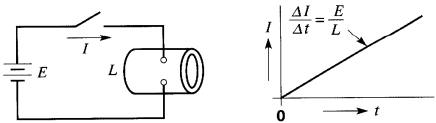
Contrairement à une résistance, le courant ne plafonne pas et il augmente théoriquement sans limite. Cependant, en pratique, le courant ne peut pas augmenter indéfiniment car il y a une limite à ce que la source peut fournir.
Notons que si l'inductance était 10 fois plus grande, le taux de croissance du courant serait 10 fois plus petit. Par conséquent, le courant augmenterait 10 fois moins vite.
Exemple 19-4
Une bobine avant une résistance négligeable possède une inductance de 4H.
Déterminer la courbe du courant en fonction du temps si la bobine est branchée sur une source de 12V.
Combien de temps est requis pour atteindre un courant de 27A?
Solution Le taux de variation du courant est :
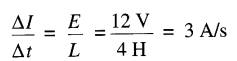
Le courant augmente à raison de 3 A/s (Fig. 19-9). Le temps requis pour atteindre 27A est de 9s.
Figure 19-9 Voir exemple 19-4.
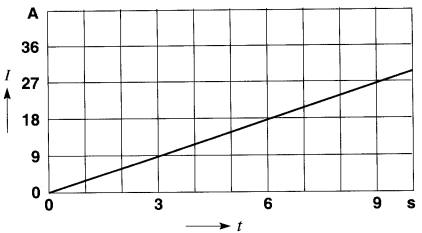
Constante de temps
En pratique, une bobine possède toujours une résistance R et une inductance L. Supposons qu'on la branche sur une source de tension E.
Si la résistance agissait seule, on obtiendrait la courbe 1, soit I = E/R (Fig. 19-10). De même, si l'inductance agissait seule, on obtiendrait la courbe 2, soit ΔI/Δt = EIL.
Figure 19-10 Pour une bobine ayant une résistance R et une inductance L, la courbe 3 décrit la variation du courant en fonction du temps. Le temps lest la constante de temps de la bobine
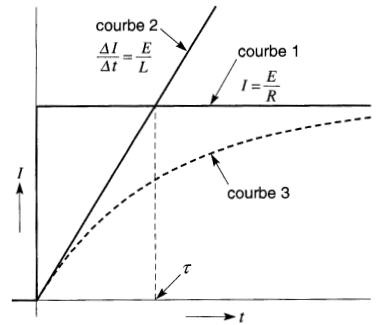
La véritable courbe 3 du courant en fonction du temps suit une trace qui est asymptotique aux courbes 1 et 2.
La courbe 3 possède une forme dite exponentielle, forme que nous discuterons à la section suivante. La courbe exponentielle possède une caractéristique appelée constante de temps τ. τ est une lettre grecque qui se prononce «tau»
La constante de temps fournit une mesure du temps requis pour qu'une grandeur comme, dans notre cas, le courant I, atteigne sa valeur finale.
On peut démontrer que la valeur de τ est égale au temps requis pour atteindre la valeur finale de I si le courant augmentait au taux déterminé par l'inductance seule. La constante de temps correspond donc au point d'intersection des courbes 1 et 2. Il s'ensuit que la valeur de test donnée par l'expression:
τ = L / R (19-7)
ou 2 = constante de temps de la bobine ou du circuit [s]
L = inductance de la bobine ou du circuit [H]
R = résistance de la bobine ou du circuit [Ω]
Exemple 19-5
Une bobine ayant une résistance de 1Ω et une inductance de 4H est connectée à une source à c.c. de 12 V (Fig. 19-11).
Figure 19-11 Voir exemple 19-5
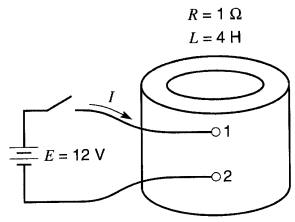
Calculer:
a) La valeur finale du courant
b) La constante de temps de la bobine
c) Les tensions, et ΔI/Δt au moment de la fermeture de l'interrupteur
d) Les tensions et ΔI/Δt lorsque le courant a atteint 8A
Solution
a) La valeur finale du courant est :
I = E/R = 12V / 1Ω = 12A
Lorsque le courant a atteint sa valeur finale, le flux ne change plus et la tension induite devient nulle.
Le temps requis pour atteindre la valeur finale dépend de l'inductance et de la résistance de la bobine : plus l'inductance est grande et plus la résistance est faible, plus le courant prend de temps à atteindre sa valeur finale.
b) La constante de temps est :
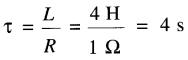
c) Le circuit de la Fig. 19-12 montre séparément la résistance et l'inductance de la bobine.
Figure 19-12 Circuit électrique équivalent au montage de la Fig. 19-11, montrant les composants R et L d'une bobine et la tension aux «bornes» de chaque élément
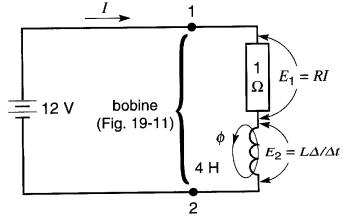
Cela permet d'analyser le courant et les tensions dans le circuit.
La tension de 12 V aux bornes de la bobine est composée de deux tensions : la chute E1 = RI dans la résistance R et la tension induite E2 = L ΔI/Δt. La tension E1 dépend de la valeur du courant I tandis que E2 dépend de son taux de variation.
Au moment de la fermeture, le courant est nul, mais il change rapidement:
E1 = 0 et E2 = 12 V.
Le taux de changement du courant à cet instant est:
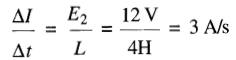
d) Lorsque le courant atteint 8A, on a E1 = 8 V. Il s'ensuit que E2 = 4 V, car la somme (E1 + E2) doit rester égale à la tension de la source (12V). Le taux de changement du courant à cet instant est:
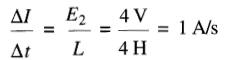
Forme de la courbe exponentielle
L'lorsqu'une grandeur Q (comme un courant ou une tension) suit une courbe exponentielle, sa variation en fonction du temps suit un trajet bien défini.
L'expression est donnée par la formule :
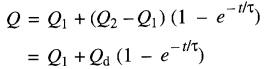 (19-8)
(19-8)
où
Q = valeur de la grandeur au temps t
Q1 = valeur initiale de la grandeur
Q2 = valeur finale de la grandeur
Qd =
Q2-Q1
t =
temps écoulé [s]
τ
=
constante de temps [s]
e =
base logarithmique (valeur = 2,718...)
Cette formule permet de
tracer toute courbe exponentielle à l'aide d'une calculatrice de poche.
Il est encore plus facile de tracer cette courbe en faisant appel à une grandeur dérivée de la constante de temps τ et appelée demi-temps T0.
La relation entre T0 et la constante de temps τ est donnée par l'expression:
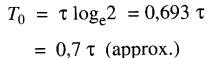 (19-9)
(19-9)
En utilisant le demi-temps T0, on peut alors dresser un tableau universel donnant les valeurs de Q à des intervalles distincts, multiples de T0. Ces valeurs sont présentées au tableau 19-1.
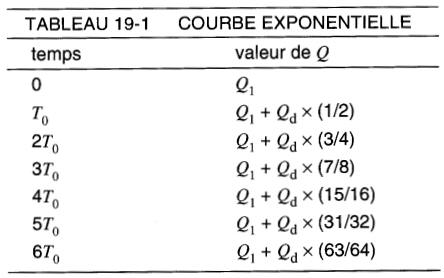
En observant les valeurs successives du tableau 19-1, on notera qu'à chaque intervalle T0 la quantité Q augmente d'une valeur qui est la moitié de celle obtenue à l'intervalle précédent. C'est pourquoi T0 s'appelle le demi-temps.
On constate qu'après une période 6T0 la valeur de Q est (63/64) de Q2 ou 98,4 % de sa valeur finale. À toutes fins utiles, on peut considérer que c'est la valeur finale.
Noter que 6T0correspond à 4,2τ, soit environ 4 constantes de temps.
Exemple 19-6
Tracer la courbe du courant en fonction du temps pour la bobine de l'exemple 19-5, sachant que le courant initial est nul.
Solution
D'après la solution de l'exemple 19-5, on sait que Q1=0A, Q2=12A, τ=4s et Qd=(12-0)=12A.
Il s'ensuit que:
T0 = 0,7τ = 0,7 x 4 = 2,8s
Les valeurs du temps t et du courant correspondant sont choisies conformément au tableau 19-1, ce qui donne le tableau 19-2.
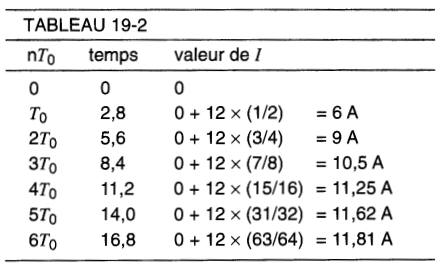
La courbe du courant en fonction du temps est montrée à la Fig. 19-13.
Figure 19-13 Courbe du courant en fonction du temps pour le circuit de la Fig. 19-11
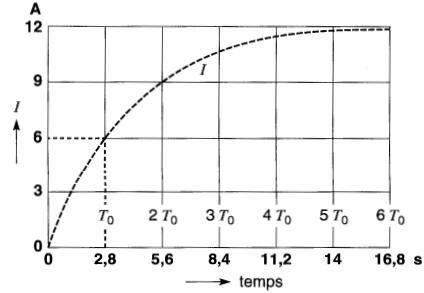
Ouverture d'un circuit inductif
Considérons une bobine d'inductance L, alimentée depuis un certain temps par une source de tension El (Fig. 19-14).
Figure 19-14 Avec un courant constant, l'énergie emmagasinée dans le champ demeure constante
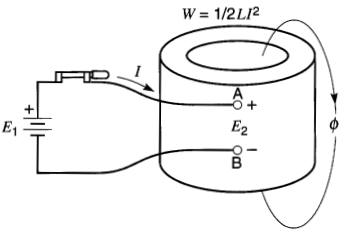
Le courant I circulant dans la bobine est constant et l'énergie emmagasinée dans le champ vaut alors (t1/2)LI² joules. La borne A est positive par rapport à la borne B.
Si l'on ouvre l'interrupteur, le courant et le flux baissent brusquement, induisant ainsi une tension élevée E2 de polarité inverse entre les bornes de la bobine (Fig. 19-15).
Figure 19-15 En ouvrant le circuit, l'énergie emmagasinée dans le champ est dissipée dans l'arc. Noter que la polarité des bornes A, B est l'inverse de celle de la figure 19-14
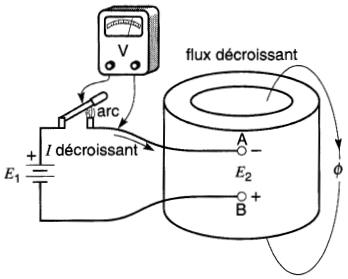
En tenant compte des polarités, on constate que la tension aux bornes de l'interrupteur est la somme de la tension induite et de celle de la source. Cette tension est tellement élevée qu'elle réussit à créer un arc à travers l'air séparant la lame des contacts fixes de l'interrupteur. Le courant continue donc à circuler à travers l'arc tout en diminuant graduellement.
Finalement, il devient trop petit pour maintenir l'arc et c'est seulement à ce moment que le circuit entre la source et la bobine est réellement ouvert.
Pendant la décroissance du courant, la bobine se comporte comme une source, et l'énergie qu'elle débite est dissipée dans la résistance de l'arc.
Lors de l'ouverture de l'interrupteur toute l'énergie emmagasinée dans le champ doit donc être dissipée dans l'arc. L'ouverture des gros enroulements à courant continu peut créer un arc assez intense pour faire fondre les contacts de l'interrupteur. On devra donc prendre des précautions particulières lors de l'ouverture d'un circuit qui contient un enroulement.
En effet, la tension induite au moment de l'ouverture du circuit peut atteindre plusieurs milliers de volts. Cette tension pourrait causer une rupture de l'isolation sur l'enroulement, ou même donner un choc électrique fatal. De plus, l'arc abîme les contacts de l'interrupteur.
Le problème de la self-induction est particulièrement grave dans les circuits de commande où des relais électromagnétiques sont alimentés et désalimentés plusieurs milliers de fois par jour. L'arc créé lors de la séparation des contacts doit être réduit par des méthodes spéciales que nous allons maintenant décrire.
Méthodes de suppression des arcs
On peut réduire la tension aux bornes de la bobine et l'intensité de l'arc en plaçant une résistance R0 en parallèle avec la bobine (Fig. 19-16).
Figure 19-16 Une résistance placée aux bornes de la bobine absorbe une partie de l'énergie du champ magnétique
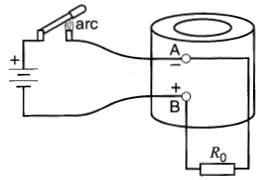
L'énergie dans le champ est alors dissipée surtout dans la résistance et plus faiblement dans l'arc d'ouverture. Plus la résistance est basse, mieux on réussit à étouffer l'arc.
Mais une faible résistance possède l'inconvénient de dissiper une puissance considérable lors du fonctionnement normal de l'enroulement. On arrive à un compromis acceptable en utilisant une résistance R0 ayant environ 3 fois la résistance de la bobine.
La solution idéale est d'employer une résistance non linéaire, comme un varistor, dont la résistance diminue brusquement lorsque la tension augmente.
Une autre méthode particulièrement efficace consiste à placer une diode en série avec la résistance R0 en avant soin de la raccorder comme indiqué sur la Fig. 19-17.
Figure 19-17 L'ajout d'une diode isole la résistance, sauf lors de l'ouverture du circuit
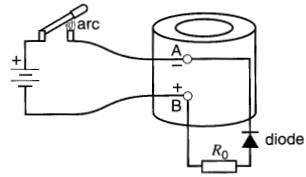
La résistance ne dissipe aucune puissance lorsque l'interrupteur est fermé, mais dès son ouverture, la polarité inverse aux bornes de la bobine permet à la diode de conduire.
Si l'on utilise une diode, on peut réduire la résistance R0 à zéro, évitant ainsi tout arc lors de l'ouverture de l'interrupteur.
Cependant, le flux créé par la bobine décroît alors très lentement avec une constante de temps τ =L/R, où L est l'inductance de la bobine et R sa résistance. Cela peut présenter un inconvénient, car s'il s'agit d'une bobine de relais, ce dernier ne réagira pas immédiatement après l'ouverture de l'interrupteur.
On peut aussi réduire l'arc en plaçant un condensateur et une résistance R1 aux bornes de l'interrupteur (Fig. 19-18).
Figure 19-18 Condensateur et résistance pour supprimer les arcs lors de l'ouverture du circuit
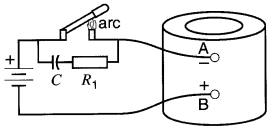
Lors de l'ouverture de l'interrupteur, le condensateur emmagasine une partie de l'énergie subitement libérée par l'inductance.
Cette énergie est ensuite lentement dissipée dans le circuit formé par la bobine, le condensateur, la source et la résistance totale du circuit.
Lorsque l'interrupteur est ouvert, le condensateur demeure chargé à la tension de la source. Le but de la résistance R1 est de limiter le courant de décharge lorsque l'interrupteur est refermé, afin de ne pas abîmer ses contacts.
Exemple 19-7
La bobine de la Fig. 19-17 possède une inductance de 12H et une résistance de 35Ω. Elle est alimentée par une source de 24 V. Afin d'éliminer l'arc lors de l'ouverture de l'interrupteur, on place aux bornes A, B une résistance R0 de 175Ω en série avec une diode.
Déterminer la forme d'onde de la tension aux bornes de la bobine à la suite de l'ouverture du circuit.
Solution
Avant l'ouverture du circuit, le courant dans la bobine est I = 24 V/35Ω = 0,686A.
Au moment de l'ouverture, ce courant demeure inchangé, à cause de l'inductance de la bobine. Comme l'arc est supprimé, le courant doit circuler dans R0 et la diode. La chute de tension dans la diode étant négligeable, la tension EAB entre les bornes A et B change subitement de signe et passe de +24V à EAB = -0,686A x 175Ω = -120V, soit EBA= +120V.
La résistance du circuit est maintenant 175 + 35 = 210Ω, alors que son inductance est toujours 12H.
La constante de temps est donc:
τ = L/R = 12H / 210Ω = 0,0571s = 57,1 ms.
Cela correspond à un demi-temps de T0 = 0,7 x 57,1 = 40ms
Le courant dans la bobine, de même que la tension a ses bornes, décroissent exponentionnellement jusqu'à zéro.
On peut alors tracer la courbe de décharge de EBA en utilisant le tableau 19-1.
Dans cet exemple, Q1 = 120 V et Q2= O V, donc Qd = Q2-Q1 = -120V
Les valeurs de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps sont présentées au tableau 19-3. La courbe de décroissance de EAB est montrée à la Fig. 19-19.
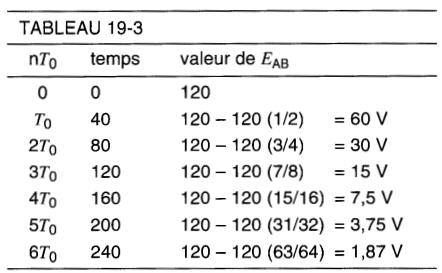
Figure 19-19 Courbe EBA en fonction du temps. Voir exemple 19-7 et Fig. 19-17
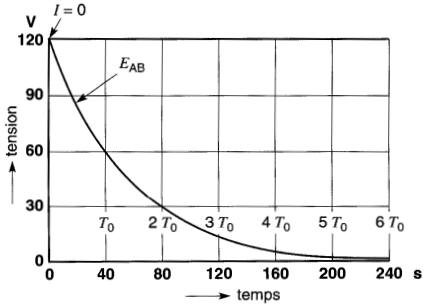
Détermination graphique du courant dans une inductance
Nous avons vu à la section 19.2 qu'il existe à chaque instant une relation entre la tension aux bornes d'une inductance et le taux de variation du courant qui la parcourt.
Cette relation est donnée par l'expression (19-4), soit:

Cette formule permet de calculer facilement la valeur de la tension E lorsqu'on connaît la forme d'onde du courant.
Cependant, il arrive souvent que la tension E aux bornes d'une inductance soit imposée et qu'on veuille calculer la valeur du courant résultant. Dans ces circonstances, à moins d'employer des mathématiques avancées, il est difficile de calculer la valeur du courant en utilisant directement la formule:
Nous utiliserons plutôt une méthode graphique appelée méthode des volts-secondes. Pour utiliser cette méthode, il s'agit de transposer l'expression ci-dessus, en la mettant sous la forme:
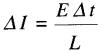 (19-4a)
(19-4a)
Comment interpréter cette nouvelle expression?
Elle nous indique que si une tension E existe aux bornes d'une inductance L durant un intervalle Δt, le courant qu'elle porte variera de ΔI.
Le changement sera d'autant plus grand que l'inductance L est petite.
Par exemple, supposons que la tension aux bornes d'une bobine soit de 40V durant un intervalle de 72ms, et que l'inductance de la bobine soit de 1,2H.
Durant cet intervalle, le changement de courant ΔI sera:
ΔI = (EΔT) / L = (40 x 0,072) / 1,2 = 2,4A
Le courant augmentera ou diminuera selon que la tension E est positive ou négative. Lorsqu'une tension varie en fonction du temps pendant une certaine période, on doit subdiviser la période en intervalles très courts. Cela permet, en effet, de garantir que la tension E reste pratiquement constante durant chaque intervalle.
Ensuite, on calcule le changement de courant durant chaque intervalle. Connaissant la valeur initiale du courant, on peut alors, en répétant le calcul de ΔI, trouver la valeur du courant tout au long de la période.
On remarquera que le produit EΔt représente la petite surface, en volts-secondes, située en dessous de la tension E durant le court intervalle Δt.
Par conséquent, afin de trouver le courant circulant dans une inductance après une période T appréciable, il faut déterminer les surfaces comprises en dessous de la courbe de tension E pendant cette période.
Les surfaces sont mesurées en volts-secondes ; elles sont positives lorsque la tension est positive et négatives lorsque la tension est négative. La surface nette après un temps T s'obtient en soustrayant les surfaces négatives des surfaces positives.
Supposons, par exemple, que la tension aux bornes dune inductance suive la courbe de la Fig. 19-20.
Figure 19-20 Courbe montrant la tension aux bornes d'une inductance (bobine) en fonction du temps
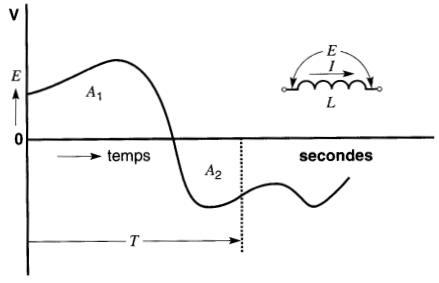
Durant la période T, la surface A1 en dessous de la courbe est positive tandis que la surface A2 est négative. Il s'ensuit que A, la surface nette à la fin du temps T est égale à (A1 -A2) volts-secondes.
Si le courant initial est zéro, sa valeur I au bout du temps Test donnée par l'expression :
I = A/L (19-10)
où
I = courant dans l'enroulement après un temps T, en ampères [A]
A = surface nette en dessous de la courbe de tension pendant le temps T, en volts-secondes [V.s]
L = inductance de l'enroulement, en henrys [H]
Considérons un enroulement ayant une inductance L et une résistance négligeable. La tension à ses bornes varie selon la courbe de la Fig. 19-21. Si le courant initial est nul, sa valeur à l'instant t1 sera:
Figure 19-21 Méthode des volts-secondes pour calculer le courant dans un enroulement
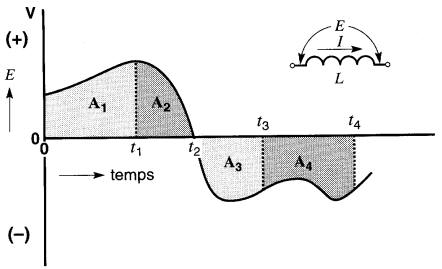
I = A1 / L
À mesure que le temps s'écoule, la surface augmente progressivement; par conséquent, le courant continue à croître. Il atteint sa valeur maximale à l'instant t2 car c est à ce moment que la surface comprise sous la courbe de tension cesse d'augmenter (Fig. 19-22).
Figure 19-22 Forme d'onde du courant dans l'enroulement
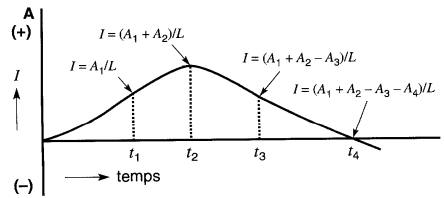
Après t2, la tension devient négative et, par conséquent, la surface nette commence à diminuer. À l'instant t3, par exemple, la surface nette est égale à (A1 + A2 - A3) et le courant correspondant est:
I= (A1 +A2 -A3) / L
À l'instant t4, la surface négative (A3 + A4) est égale à la surface positive (A1 + A2). Par conséquent, la surface nette est nulle et le courant redevient nul, comme il l'était à t = 0.
Après l'instant t4, le courant devient négatif, c'est-à-dire qu'il change de sens (Fig. 19-21 et 19-22).
Note importante: si le courant initial (t = 0) est I0 au lieu de zéro, il suffit d'ajouter I0 à chacune des valeurs calculées selon la méthode des volts-secondes.
Exemple 19-8
La tension E aux bornes d'une bobine de 2 H suit la courbe donnée à la Fig. 19-23.
Figure 19-23 Voir exemple 19-8
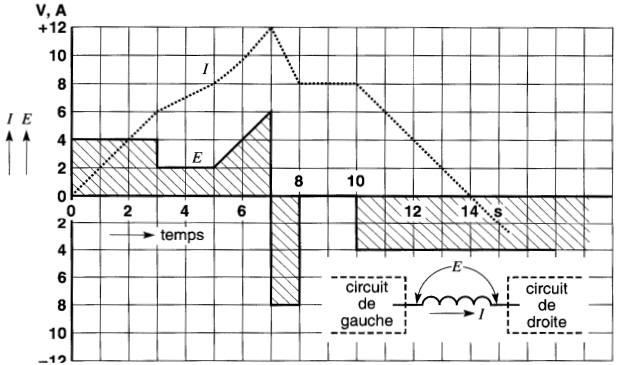
Sa résistance est négligeable.
Déterminer la valeur du courant instantané I dans le circuit, sachant que le courant initial est nul.
Solution
Intervalle de 0 à 3 secondes :
pendant cet intervalle, la tension de 4V aux bornes est constante. Donc, la surface en volts-secondes augmente uniformément et linéairement.
Ainsi, après 1 seconde la surface est de 4 V•s, après 2 secondes elle est de 8 V•s, après 3 s, de 12 V•s.
Le courant I est donné par la relation I = A/L, où L = 2H; le courant prend donc les valeurs respectives de 2A, 4A, etc., pour atteindre 6A après 3 secondes.
Intervalle de 3 à 5 secondes:
la tension baisse subitement à 2V durant 2s.
La surface continue à augmenter mais à un taux moins rapide, car la tension E est plus petite qu'auparavant.
Lorsque t =5 s, la surface totale en dessous de la courbe depuis le début est de 16 V•s ; par conséquent, le courant
I = A/L = 16 V•s / 2H = 8A.
Intervalle de 5 à 7 secondes:
pendant cette période la tension augmente de 2V à 6V.
La surface augmente de 4 carreaux, ce qui équivaut à 8 V•s, donc à une augmentation de courant de 4A.
Le courant à t = 7s est donc 8A + 4A =12A.
Remarquer que la courbe du courant n'est pas une droite pendant cet intervalle, car la tension n'est pas constante.
Intervalle de 7 à 8 secondes:
la tension change subitement de polarité, passant de 6V à -8V, de sorte que les 8 V•s compris dans cet intervalle se soustraient des volts-secondes accumulés précédemment.
La surface nette depuis le début est donc 24 V•s -8 V•s = 16 V•s.
Par conséquent, le courant à la fin de cet intervalle (t = 8 s) est: I=16V•s / 2H= 8A.
Intervalle de 8 à 10 secondes:
la tension est nulle aux bornes de l'inductance. La surface nette demeure inchangée; par conséquent, le courant ne change pas, mais reste à 8A.
Intervalle de 10 à 14 secondes: la tension est -4V et les volts-secondes négatifs continuent à s'accumuler.
À t = 14 s, l'ensemble des surfaces négatives est égale à l'ensemble des surfaces positives, de sorte que le courant redevient nul.
Passé cet instant, le courant change de sens.
Si le courant avait eu une valeur initiale, disons, de +7A, on devrait ajouter cette valeur à chacun des courants calculés ci-dessus.
Pour obtenir la nouvelle courbe de courant, il suffirait de décaler la courbe de la Fig. 19-23 de 7A vers le haut. Ainsi, le courant à t = 7s serait 12 + 7 = 19A.
FORMULES POUR CALCUL D'INDUCTANCES
Le calcul de l'inductance pour certains enroulements et pour certaines formes de conducteurs est particulièrement utile. Les formules données dans les exemples qui suivent sont approximatives, mais suffisamment précises pour les applications pratiques.
Bobine à noyau de fer ayant un entrefer
L'inductance de ce type de bobine (Fig. 19-24) dépend surtout des dimensions de l'entrefer, le noyau de fer ne servant qu'à canaliser le flux.
Figure 19-24
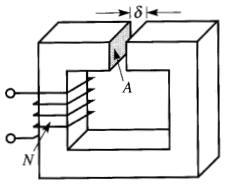
Pour un noyau de fer très perméable, l'inductance est donnée par la formule :
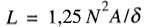 (19-11)
(19-11)
où
L = inductance, en microhenrys
[gH]
N = nombre de spires de la bobine
A = surface de l'entrefer, en
mètres carrés [m 2] = longueur de l'entrefer,
en mètres [m]
= longueur de l'entrefer,
en mètres [m]
Exemple 19-9
Dans la Fig. 19-24, si N = 1000
spires, A = 4 cm x 1,5 cm,
 = 1 mm, on obtient :
= 1 mm, on obtient :
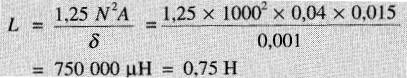
Bobine toroïdale à noyau d'air Une bobine toroïdale (Fig. 19-25) possède l'avantage de ne créer aucun flux à l'extérieur de ses spires.
Figure 19-25
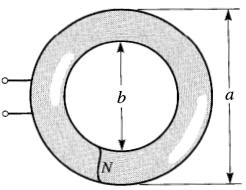
Lorsque les spires sont réparties uniformément, la bobine possède une inductance donnée par la formule :
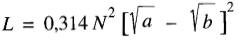 (19-12)
(19-12)
où
L = inductance, en
microhenrys [µH]
N = nombre de spires
a = diamètre extérieur, en mètres
[m]
b = diamètre intérieur, en mètres [ml
Exemple 19-10
Dans la Fig. 19-2 si N = 1000, a = 40 cm, b = 30 cm, on obtient :
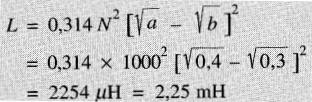
Bobine à noyau d'air
Les bobines droites (Fig. 19-26) sont très répandues dans les circuits à basses et à hautes fréquences.
Figure 19-26
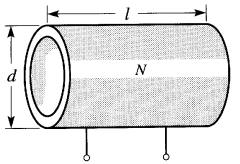
L'inductance de ces bobines est donnée par la formule :
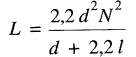 (19-13)
(19-13)
ou
L = inductance, en
microhenrys [µH]
N = nombre de spires
d = diamètre moyen, en mètres [ml
l = longueur, en mètres [m]
Note: Si l/d > 0,2, la précision de la formule est plus petite que ± 3 %.
Exemple 19-11
Dans la Fig. 19-26, si N = 1000, d = 40 cm, 1 = 20 cm, on obtient:
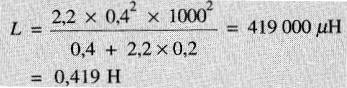
Rouleau de fil à noyau d'air
Bien que ce type de bobine (Fig. 19-27) soit peu utilisé (elle est utilisée dans les radios voir Barre d'antenne AM, Air coil inductor), la formule suivante permet de déterminer l'inductance approximative des bobines courtes ayant un grand diamètre.
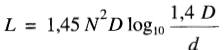 (19-14)
(19-14)
Figure 19-27
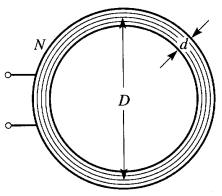
où
L = inductance, en microhenrys[µH]
N = nombre de spires
D = diamètre moyen, en mètres [m]
d = diamètre du faisceau de spires [m]
Exemple 19-12
Dans la Fig. 19-27, si N= 1000, D = 40 cm, d = 2,5 cn1, on a:
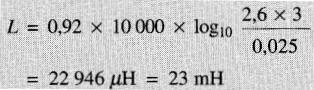
eux conducteurs parallèles Deux conducteurs longs et parallèles (Fig. 19-28) forment une grande spire possédant une inductance appréciable.
Figure 19-28
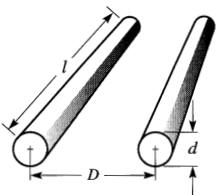
Cette inductance joue un rôle important dans les lignes de transport de l'énergie électrique.
L'inductance est donnée par la formule :
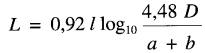 (19-15)
(19-15)
où
L = inductance, en microhenrys
[µH]
l = longueur des conducteurs, en mètres [m]
D = distance séparant les
centres, en mètres [m]
d = diamètre des conducteurs, en mètres [m]
Exemple 19-13
Dans la Fig. 19-28, si l = 10 km, D = 3 m, d = 25 mm, on a:
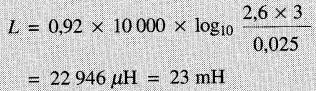
Deux barres omnibus parallèles
Tout comme deux conducteurs circulaires, deux barres omnibus (Fig. 19-29) forment une spire dont l'inductance est donnée par la formule:
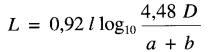 (19-16)
(19-16)
Figure 19-29
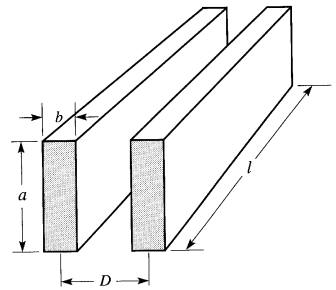
où
L = inductance, en
microhenrys [µH]
l = longueur des barres, en mètres [m]
D = distance entre
les centres, en mètres [m]
a = largeur d'une barre, en mètres [m]
b =
épaisseur d'une barre, en mètres [m]
Note: Cette formule donne une précision plus petite que ± 2 % si: D > (a+b) / 2 et l > 60D
Exemple 19-14
Dans la Fig. 19-29, si l = 12 m, D = 8 cm, a = 7 cm, b = 10 mm. on obtient:
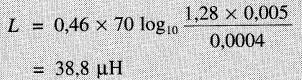
Deux conducteurs concentriques Les conducteurs circulaires concentriques (Fig. 19-30) sont utilisés pour le transport de l'énergie (câbles souterrains), de même que dans le domaine des communications (câbles coaxiaux).
Figure 19-30
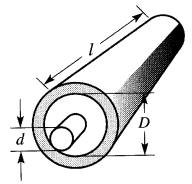
Leur inductance est donnée par la formule:
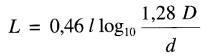 (19-17)
(19-17)
où
L = inductance, en
microhenrys [pH]
l = longueur du conducteur, en mètres [m]
D = diamètre
intérieur du conducteur extérieur, en mètres [m]
d = diamètre du conducteur
intérieur [m]
Exemple 19-15
ans la Fig. 19-30, si l = 70 m, D = 5 mm. d= 0,4 min, on obtient:
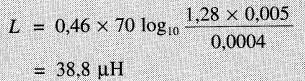
Résumé
Dans cette section nous avons introduit deux nouvelles grandeurs qui jouent un rôle fondamental dans tous les circuits contenant des bobines : la self-inductance, plus simplement appelée inductance, et l'inductance mutuelle.
Lorsqu'un courant varie dans une bobine avec un taux de changement ΔI/Δt, le changement de flux induit une tension entre les bornes de cette même bobine. Cette tension est fonction de l'inductance L de la bobine selon la loi fondamentale E = LΔI/Δt.
L'unité SI de mesure de l'inductance est le henry (H).
De la même façon, lorsqu'un courant varie dans une bobine avec un taux de changement ΔI/Δt, le changement de flux induit une tension E entre les bornes d'une autre bobine voisine qui « accroche » les lignes de force créées par la première.
La tension induite dans la deuxième bobine est fonction de l'inductance mutuelle M entre les deux bobines selon la loi fondamentale E = MΔI/Δt.
L'unité SI de mesure de l'inductance mutuelle est également le henry. Nous avons vu que la loi de Lenz permet de déterminer la polarité de la tension induite dans une bobine lorsque le courant augmente ou diminue. Retenons que lorsque le courant augmente, la borne par où pénètre le courant est positive.
Nous avons aussi donné une formule simple permettant de calculer l'énergie emmagasinée dans une bobine, connaissant le courant et l'inductance.
Lorsqu'une tension continue est appliquée à une bobine d'inductance L en série avec une résistance R (qui peut être la résistance de la bobine elle-même), le courant augmente en fonction du temps selon une courbe exponentielle. Le temps requis pour atteindre un courant stable dépend de la constante de temps τ = L/R.
Nous avons aussi introduit une autre grandeur, le demi-temps T0. Un tableau universel permet de tracer facilement les courbes exponentielles.
Enfin, plus généralement, lorsque la tension appliquée à une inductance n'est pas continue mais varie de façon quelconque, on peut tracer la forme de l'onde du courant en calculant les volts-secondes compris sous la courbe de tension.
Enfin, nous avons vu que lors de l'ouverture d'un circuit contenant une bobine, le phénomène de self-induction peut générer des tensions élevées aux bornes de la bobine et produire des arcs aux bornes de l'interrupteur. Nous avons présenté plusieurs méthodes pour supprimer les arcs.
PROBLÈMES
Niveau pratique
19-1 Donner la définition de l'inductance mutuelle et celle du henry.
19-2 Qu'est-ce que la self-inductance?
19-3 Définir l'inductance d'une bobine.
19-4 Quel est l'effet de la self-induction à l'ouverture d'un circuit? à la fermeture d'un circuit?
19-5 Une tension de 40V est induite lorsque le courant dans une bobine change de 5A à 1A en 0,4s. Quelle est l'inductance de la bobine?
19-6 Une bobine a une résistance de 10Ω et une inductance de 5H. Si la bobine est raccordée à une source à c.c. de 100V, quelle est la valeur du courant initial? du courant final?
19-7 Dans la Fig. 19-1, le voltmètre indique 10V lorsque le courant la augmente à un taux de 40 A/s. Si le courant diminue à un taux de 60 A/s, quelle sera la valeur de la tension enregistrée?
19-8 Donner deux méthodes permettant de limiter la surtension aux bornes d'une bobine.
Niveau intermédiaire
19-9 L'inductance mutuelle entre deux bobines est de 5H. Quelle est la valeur moyenne de la tension induite dans une bobine lorsque l'intensité du courant dans l'autre décroît de 15A à 5A en 0,5s?
19-10 Une bobine ayant une inductance de 3H est parcourue par un courant de 6A.
a) Quelle est la valeur moyenne de la tension induite quand ce courant est interrompu en 1/30e de seconde?
b) Quelle était l'énergie dans le champ magnétique?
19-11 L'inductance de lissage de la Fig. 19-3 possède une résistance de 4 mΩ et porte un courant continu de 6000A.
a) Quelle est l'énergie emmagasinée dans le champ?
b) Quelle est la tension aux bornes?
c) Quelle est la constante de temps de l'inductance?
19-12 Dans la Fig. 19-12, le courant augmente graduellement de zéro jusqu'à 12A.
a) Quelles sont les chutes de tension RI lorsque le courant est de 1A? 5A? 10A?
b) Quelles sont les tensions induites lorsque le courant est de 1A, 5A, 10A?
c) Quelles sont les puissances dissipées par effet Joule lorsque le courant est de 1 A? 5 A? 10 A?
d) Quelle puissance est fournie au champ magnétique lorsque le courant est de 1A? 5A? 10A?
19-13 Une des conséquences importantes de l' inductance est qu'il est impossible de changer le courant instantanément dans une bobine. La bobine de la Fig. 19-17 possède une inductance de 2H et une résistance de 20Ω. La tension de la source est de 40 V et la résistance extérieure R0 est de 100Ω.
a) Quelle est la tension maximale aux bornes AB au moment de l'ouverture de l'interrupteur?
b) Quelle est la tension maximale induite dans la bobine?
19-14 Dans le problème 19-13, s'il faut limiter la tension aux bornes AB à 600 V, quelle valeur de R0 doit-on utiliser?
19-15 Une bobine semblable à celle de la Fig. 19-26 possède une longueur de 100 cm et un diamètre moyen de 20 cm. Si elle contient 1200 spires, quelle est son inductance?
19-16 Dans la Fig. 19-1, le voltmètre indique une tension de 120 V lorsque le courant Ia varie à un taux de 2 kA/s. Si l'on intervertit la source et le voltmètre, quelle sera la lecture de l'instrument si le courant varie à un taux de 500 A/s?
19-17 On applique une tension de 12V aux bornes d'une inductance de 2 H dont la résistance est négligeable.
Quel est le courant dans la bobine après 0,1s? après 8s? après 1 min? après 1 h?
19-18 Si la bobine du problème 19-17 possède une résistance de 0,35Ω, calculer la constante de temps τ de même que le demi-temps T0. Tracer la courbe du courant en fonction du temps.
Quelle est la valeur du courant après 0,1 s? après 8 s? après l min? après 1 h?
19-19 Une bobine enroulée sur un noyau de fer (Fig. 19-24) possède une inductance de 5H. Si l'on réduit la longueur de l'entrefer de moitié, quelle sera l'inductance?
Si l'on double le nombre de spires, quelle sera l'inductance?
19-20 Un rouleau de fil (Fig. 19-27) de 600 spires possède une inductance de 90 mH. Si l'on enlève 60 spires, quelle sera la nouvelle inductance?
19-21 Deux conducteurs #1/0 (diamètre 8,26 mm) ont une longueur de 40 km. Si la distance entre les conducteurs est de 0,5 m, quelle est l'inductance de la ligne?
19-22 Dans le problème 19-21, quelle serait la nouvelle inductance si l'on doublait le diamètre du fil?
19-23 Le courant dans une inductance de 2H varie selon la courbe donnée à la Fig. 7-30.
a) Tracer la tension aux bornes de l'inductance en fonction du temps.
b) Quelle est la tension à 25 s? à 45 s?
19-24 La Fig. 19-31 représente la tension aux bornes d'une inductance de 0,5H dont la résistance est négligeable. Le temps est donné en millisecondes et le courant initial est nul.
a) En faisant une estimation assez précise de la grandeur des surfaces, trouver la valeur du courant après 10ms et après 20ms.
b) Quel est le courant maximal si le courant initial est de +8A?
Figure 19-31 Méthode des volts-secondes pour calculer le courant dans un enroulement
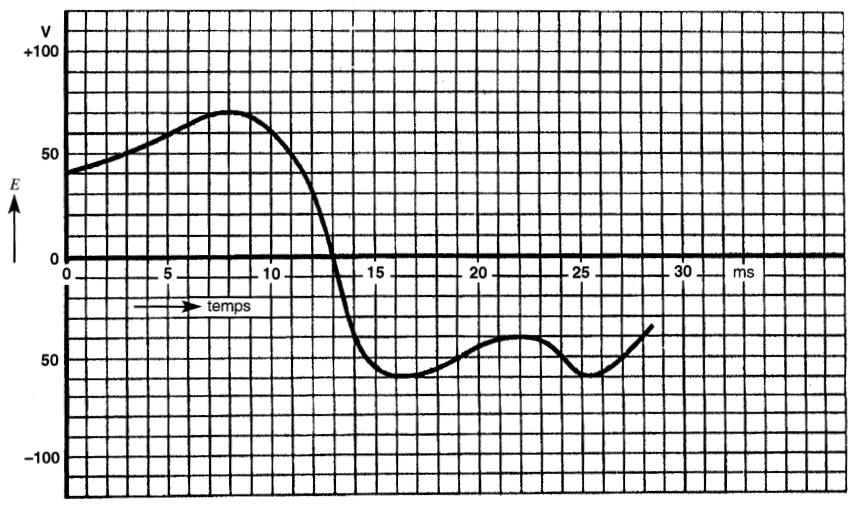
19-25 Une tension ayant la forme donnée à la Fig. 7-21 est appliquée sur une inductance de 2,5H dont la résistance est négligeable.
a) Tracer le courant en fonction du temps si sa valeur initiale est nulle.
b) Quel est le courant après 4s? 10s? 7,2s?
19-26 Dans le problème 19-25, tracer le courant en fonction du temps si la valeur initiale est de -20A.
Niveau avancé
19-27 Dans la Fig. 19-1, le flux θa est de 12 mWb lorsque Ia = 6A.
D'autre part, on sait que 20 % du flux θa est capté par la bobine B.
Enfin, les bobines A et B ont respectivement 200 et 2000 spires et leur résistance est négligeable.
Si le courant Ia augmente à un taux de 2000 A/s, calculer:
a) la tension de la source Ea
b) la tension lue par le voltmètre
c) l'inductance de self de la bobine A
d) l'inductance mutuelle
19-28 La ligne du problème 19-21 est alimentée par une source de 70,7 kV (c.c.) et la charge est composée d'une résistance de 675Ω.
a) Si la résistance de chaque conducteur est de 0,4 S2/km, calculer la constante de temps du circuit composé de la ligne et de la charge?
b) Quels sont le courant dans la ligne et la tension aux bornes de la charge 160 gs après fermeture de l'interrupteur?
c) Quelle est la tension induite dans la ligne à cet instant?
19-29 La bobine d'un relais possède une résistance de 10Ω et une inductance de 2 mH. Calculer la tension aux bornes lorsque la bobine porte un courant de 3A qui croît à un taux de 10 kA/s.
19-30 Dans le problème 19-29, si le courant de 3 A décroît à un taux de 10 kA/s, quelle est la tension aux bornes de la bobine?
19-31
a) Calculer les self-inductances de chaque bobine auxiliaire de la Fig. 13-25b.
b) Quelle est la self-inductance lorsque les deux bobines sont branchées en série et quelle est la constante de temps? (Utiliser les données du tableau 13.1.)
19-32
a) Calculer la self-inductance de chaque bobine principale de la Fig. 13-25b.
b) Si les deux bobines sont branchées en parallèle, calculer la self-inductance de l'ensemble, de même que la constante de temps.
19-33 En prenant comme référence la Fig. 19-26, prouver qu'une bobine de N spires, dont la longueur 1 est beaucoup plus grande que le diamètre d, possède une inductance L = d²N² / l microhenrys.
19-34 Calculer l'inductance de la bobine illustrée à la Fig. 14-3, en négligeant l'épaisseur du fil.
Réponses
5) 4H; 6) 0A; 10A; 7) -15V; 9)
100V; 10a) 540V;
10b) 54 J; 11a) 324 kJ; 11 b) 24V; 11 c) 4,5s;
12a) 1V;
5V; 10V; 12b) 11V; 7V; 2V; 12c) 1W; 25W; 100W;
12d) 11W; 35W; 20W; 13a)
200V; 13b) 240V; 14) 300Ω;
15) 52,8 mH; 16) 30V; 17) 0,6A; 48A; 361A;
21,6 kA;
18) 0,594A; 25,83A; 34,29A; 34,29A; 19) 10H, 20H;
20) 72,9 mH;
21) 80,8 mH; 22) 69,8 mH; 23b) -4V; 2V;
24a)-1,15A; - 0,7A; 24b) - 9,4A; 25b)
36A; 0A; 23,6A;
27a)800V; 27b) 1600V; 27c) 0,4H; 27d) 0,8H; 28a) 114µs;
28b)75,4A; 50,9kV; 28c) 17,7kV; 29) 50V; 30) 10V;
31 a)3,16H; 31 b) 12,6H;
63s; 32a) 119H; 32b) 118H; 382s;
34) 80,4 µH